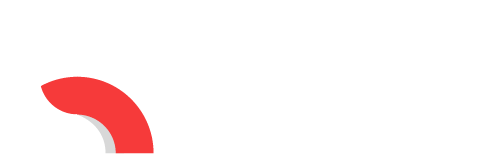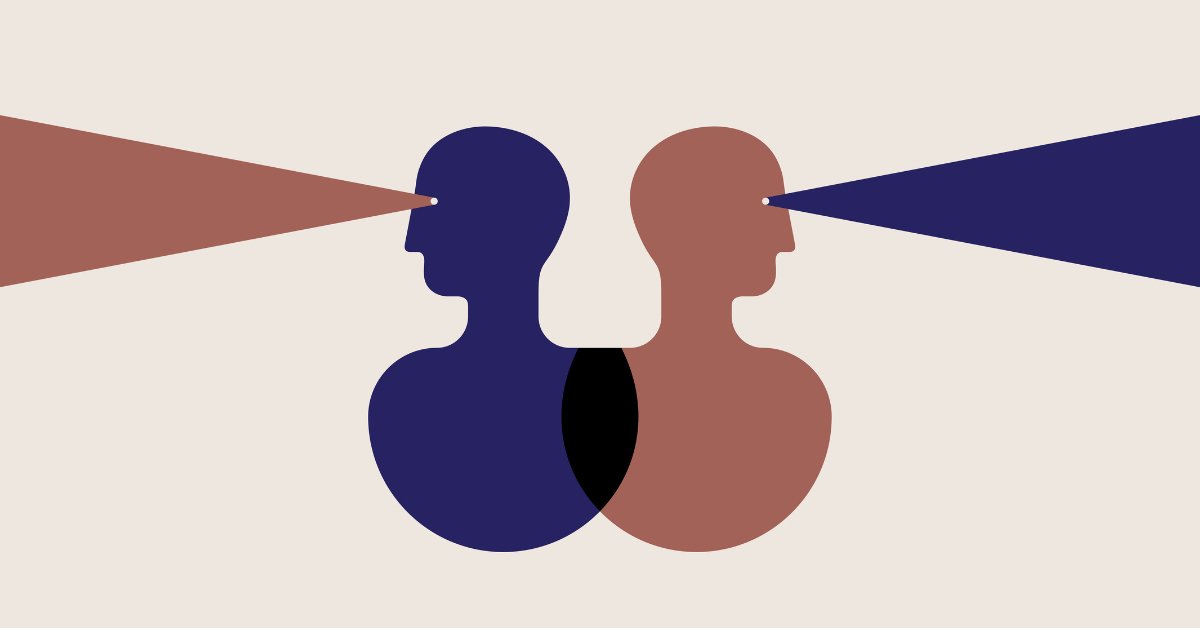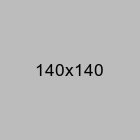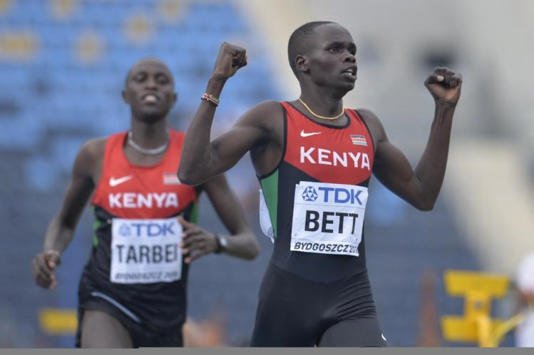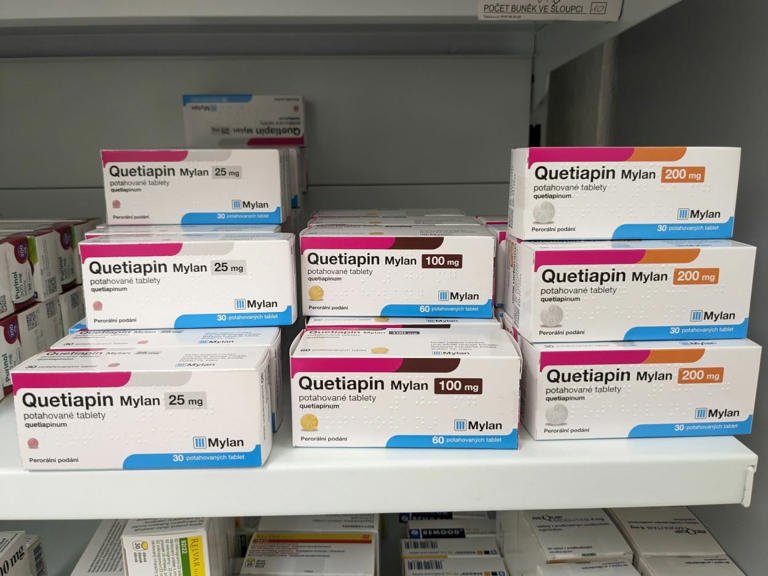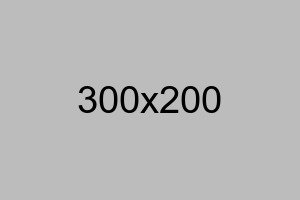Les règles sont en train de changer. Alors que les plateformes sociales et les géants de la tech ont imposé leur vision pendant des années, s’octroyant monopoles, puissance et influence, les États semblent en passe de reprendre le contrôle des débats. Ils n’hésitent plus à imposer leurs conditions face à des pratiques allant de l’immoral à l’illégal, grâce notamment à des jeux de pouvoir et à des arsenaux législatifs de plus en plus adaptés à leur époque. Derniers exemples en date : la soumission de X et de Telegram, des milliardaires Elon Musk et Pavel Durov, aux pressions étatiques, brésiliennes pour le premier, françaises et européennes pour le second.
X et Telegram : de la résistance à la soumission face aux autorités
Les cas récents de X (ex-Twitter) et de Telegram montrent à quel point même les plateformes les plus influentes et dirigées par des figures prônant la liberté d’expression la plus totale peuvent plier sous la pression des États.
X au Brésil : la vision muskienne de la liberté d’expression mise à l’épreuve
Elon Musk, chantre autoproclamé de la liberté d’expression, a vu sa plateforme X subir une importante pression au Brésil. Tout a commencé en avril 2024, lorsque la Cour suprême brésilienne a ordonné à la plateforme de supprimer plusieurs comptes accusés de diffuser de fausses informations et des discours de haine, particulièrement en lien avec les élections de 2022, qui avaient vu la défaite de l’ancien président Jair Bolsonaro.
Elon Musk, fidèle à son positionnement, a d’abord résisté à ces injonctions, arguant que ces demandes étaient illégales et contraires aux principes de liberté d’expression de la plateforme. Cependant, cette résistance a eu un coût. Face au refus de X, les autorités brésiliennes ont fini par bloquer la plateforme, coupant ainsi l’accès à environ 20 millions d’utilisateurs. Ce blocage a rapidement eu des répercussions économiques, entraînant une perte d’activité significative pour X.
Trois semaines plus tard, après avoir évacué son personnel local par crainte d’arrestations, Elon Musk a dû se résigner à se soumettre aux exigences brésiliennes. La plateforme a finalement accepté de bloquer les comptes concernés et a nommé un nouveau représentant local, comme l’avait exigé la Cour Suprême. Ce revirement souligne les contradictions du milliardaire : s’il s’affirme comme un défenseur acharné de sa liberté d’expression, il s’est vu contraint de céder face à la réalité des lois locales et des impératifs financiers.
Telegram : Pavel Durov face aux réalités judiciaires
De son côté, Telegram, dirigé par Pavel Durov, a longtemps cultivé une image de plateforme défendant farouchement la confidentialité de ses utilisateurs et se montrant réticente à toute collaboration avec les gouvernements. Pourtant, en septembre 2024, le PDG franco-russe a annoncé un tournant dans la politique de modération du réseau. Après son arrestation à Paris en août dans le cadre d’une enquête sur le manque de coopération de la plateforme avec les autorités, Pavel Durov a révélé que Telegram avait renforcé sa modération et qu’il collaborerait désormais davantage avec la justice.
Nous constatons en effet que Telegram se montre plus coopératif ces derniers temps, a livré le parquet fédéral belge au Monde.
Les règles de la plateforme ont en effet été modifiées pour permettre la transmission aux autorités des adresses IP et numéros de téléphone des utilisateurs suspectés de participer à des activités criminelles, y compris autres que le terrorisme, qui était jusqu’alors le seul motif de coopération avec les autorités. Pavel Durov a justifié ce changement par la nécessité de lutter contre les pratiques illégales sur Telegram, comme la vente de produits volés, de drogues, d’armes, ou l’échange de contenu pédopornographique. Ce virage est significatif : il illustre comment même les plateformes les plus réfractaires aux exigences étatiques peuvent – doivent ? -, sous la pression judiciaire, se soumettre à ces dernières.
L’Union européenne, pionnière de la régulation des géants de la tech
Si les cas de X et Telegram montrent comment des plateformes peuvent plier face aux exigences locales, l’Union européenne a pris les devants dans la régulation des géants de la tech à travers des législations comme le Digital Markets Act (DMA) et le Digital Services Act (DSA).
Le DMA : une régulation stricte pour limiter le monopole des géants
Adopté en 2022 et entré en vigueur progressivement à partir de 2023, le DMA vise à limiter les abus de position dominante des grandes plateformes numériques, comme Apple, Google ou Meta. Ces entreprises, qualifiées de “contrôleurs d’accès” en raison de leur pouvoir sur les marchés, doivent désormais se conformer à des règles strictes visant à garantir une concurrence équitable. Parmi celles-ci, l’interdiction pour ces plateformes de favoriser leurs propres services par rapport à ceux de tiers est un point clé.
Apple, en particulier, a dû revoir certaines de ses pratiques, comme l’obligation pour les développeurs d’utiliser son système de paiement sur l’App Store. Face à ces nouvelles contraintes, le groupe a décidé de reporter le lancement de son système d’intelligence artificielle, Apple Intelligence, dans l’Union européenne. Ce report, annoncé à l’été 2024 avant le déploiement d’iOS 18 et des nouveaux systèmes d’exploitation de la firme, s’explique par les incertitudes réglementaires liées au DMA, qui compliquent la stratégie d’Apple en matière d’IA et de services intégrés sur ses appareils. Meta, de son côté, fait face aux mêmes problèmes et retarde également le déploiement européen de ses fonctionnalités Meta AI, en raison de profond désaccord avec l’UE sur la collecte et l’utilisation des données des utilisateurs.
Le DSA : un encadrement renforcé de la modération des contenus
Le Digital Services Act (DSA), quant à lui, vise à responsabiliser les plateformes concernant les contenus qu’elles hébergent. Les géants du numérique doivent désormais mettre en place des mesures pour mieux modérer les contenus illégaux et protéger les utilisateurs des risques en ligne. Ce texte a des répercussions directes sur des plateformes comme X et Telegram, qui doivent adapter leurs politiques de modération aux exigences européennes en matière de sécurité en ligne et de respect des lois.
Des échanges tendus ont par exemple eu lieu entre Thierry Breton, désormais ex-commissaire européen chargé notamment du numérique, et Elon Musk, quant à la responsabilité de X sur le contenu publié sur la plateforme. Le Français avait en effet affiché sa volonté de mettre fin au “Far West numérique” en Europe, prenant tout particulièrement à partie le réseau social du milliardaire américain où les publications problématiques et idées nauséabondes sont de plus en plus mises en avant. À la démission de Thierry Breton de son poste en septembre 2024, sur fond de désaccords avec la présidente Ursula von der Leyen, Elon Musk s’est fendu d’un “Bon voyage !” — en français dans le texte — tandis que la directrice générale de X, Linda Yaccarino, s’est réjouie d’une “belle journée pour la liberté d’expression”.
Bon voyage
— Elon Musk (@elonmusk) September 18, 2024
La pression mondiale sur les plateformes : un phénomène global
Le contrôle des plateformes numériques et sociales par les États n’est pas qu’un phénomène européen. À travers le monde, les gouvernements tentent de reprendre la main ou de maintenir le contrôle sur les géants de la tech, chacun avec ses propres motivations et outils législatifs.
En Chine et en Russie, des modèles de contrôle total
La Chine et la Russie, notamment, se distinguent par des approches plus directes et autoritaires dans leur contrôle des plateformes numériques. La Chine impose depuis longtemps des restrictions drastiques sur les contenus en ligne via le Great Firewall, son outil de surveillance et de censure d’Internet, tandis que la Russie exige une coopération étroite des plateformes avec les autorités, sous peine de blocage. Telegram, par exemple, a dû coopérer avec les autorités russes après avoir été temporairement bloqué pour son refus de partager des données avec le gouvernement.
Les États-Unis vers une régulation plus stricte ?
Même aux États-Unis, traditionnellement plus permissifs, les débats sur la régulation des grandes plateformes sont de plus en plus présents. La Federal Trade Commission (FTC) et d’autres institutions mènent des enquêtes sur les pratiques monopolistiques d’entreprises comme Google et Meta, dans un contexte où le contrôle des contenus et la protection des données personnelles deviennent des enjeux de plus en plus cruciaux. Parallèlement, la question TikTok reste très présente dans les débats, avec la crainte étasunienne d’une surveillance chinoise via le réseau social appartenant à ByteDance, alors que l’arrivée en force de l’IA interroge également les autorités sur la nécessité d’une régulation.
Des jeux de pouvoir à un nouvel équilibre entre liberté et régulation ?
Les cas récents de X, Telegram, Apple et d’autres montrent que même les géants de la tech, longtemps perçus comme des entités transnationales puissantes et quasi incontrôlables, se retrouvent désormais contraints de se plier aux exigences des États. Cette tendance est portée par un cadre législatif de plus en plus étoffé, en particulier en Europe, où des lois comme le DMA et le DSA imposent des règles strictes à ces grandes plateformes.
Cependant, ces régulations soulèvent aussi des questions parmi les acteurs de la tech : à quel point ces interventions étatiques freinent-elles l’innovation ? Et surtout, comment trouver l’équilibre entre protection des citoyens et préservation de la liberté d’expression, notamment quand la définition de cette dernière varie selon les points de vue, pays et habitudes culturelles ? Les crises entre les grandes entreprises et plateformes numériques pourraient donc se multiplier au cours des prochains mois, mais les États semblent bien déterminés à avoir le dernier mot et ainsi asseoir leur autorité.
;